

Sciences humaines et sociales > Accueil > Technologie et innovation > Numéro
Le jeu sérieux en tant qu’artefact tout autant qu’activité est très ancien. Nous profitons de l’introduction de ce numéro de la revue Technologie et innovation pour parcours certains points saillant de l’histoire des pratiques et dispositifs ludiques utilisés à des fins sérieuses. L’histoire de ces jeux peut remonter aux premiers hommes, ou aux premiers osselets et dés qui ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques. Mais en termes d’écrits, c’est à partir du Ve siècle avant notre ère que les premières références aux jeux dans un cadre utilitaire se manifestent. Très vite identifié pour certaines de ses qualités pour l’enseignement chez l’enfant tel que ou chez l’adulte par métaphore, il est aussi détourné à des fins moins louables que les paris, la mise en scène du pouvoir ou la manipulation des foules. Si ses pratiques ne disparaissent pas au fil des siècles, elles se font plus discrètes jusqu’à l’an 1000 où elles reprennent des couleurs. Il faut tout de même attendre le XVIIIe siècle pour que de nouvelles activités ludo-utilitaires apparaissent. L’enseignement via des jeux chez les enfants et les militaires voient de multiples expérimentations. Avec les wargames, les jeux militaires servent aussi à tester des idées. Ensuite, ce sont les jeux d’entreprises et de santé qui se développent largement jusqu’à l’ère de l’informatique. En effet, le numérique dès ces débuts propose de nouveaux usages sérieux pour les jeux et dès les années 1970 permet le développement d’une variété de jeux utilitaires dont le nombre au fil des décennies n’a fait que croître de manière exponentielle. Cela a permis l’émergence de nombreuses sous-catégories (jeux publicitaires, jeux d’informations, jeux persuasifs, jeux à buts, jeux agiles …) et la résurgence d’activités fondées sur des jeux analogiques ou composants de ces derniers (serious gaming, serious play, ludification, …).
L’objectif de cet article est de questionner si le Serious Game correspond à une invention humaine. Pour répondre à une telle interrogation, nous proposons de vérifier si du jeu sérieux peut être recensée dans le règne animal. Si un tel recensement s’avérait négatif, alors nous serions en mesure d’en conclure que le Serious Game pourrait effectivement correspondre à une invention humaine. Dans le cas contraire, le jeu sérieux serait plutôt à considérer comme une activité (Serious Play) inter-espèce. Cela nous conduirait alors à étudier s’il est possible de dégager des aspects communs et des spécificités selon les espèces. Si en parallèle, il est possible de recenser des animaux faisaient également usage d’objets pour jouer à des fins utilitaires, alors nous pourrions voir le Serious Game non pas comme une invention mais plutôt comme faisant l’objet d’innovations chez l’Homme. Pour conduire cette étude, nous mènerons une analyse hypothéticodéductive croisant des lectures issues de l’éthologie, de la biologie et des sciences humaines.
La cybersécurité est l’une des professions en pleine expansion, nécessitant un nombre croissant de décideurs compétents. Le besoin de prendre des décisions adéquates ne se limite pas seulement aux spécialistes des technologies de l’information et de la communication (TIC), mais relève également largement de la responsabilité de la direction. L’une des méthodes pour améliorer la prise de décision est de s’exercer à travers des jeux sérieux basés sur des scénarios offrant une révision de la préparation avant qu’une crise ne se matérialise. Le champ de décision change également avec l’arrivée de nouveaux acteurs : des groupes motivés politiquement, financièrement et psychologiquement ciblant les actifs cybernétiques. Les jeux sérieux traitent souvent la sécurité en termes d’équipes rouge (chargée de l’offensive) et bleue (chargée de la défense). Cet article cartographie les différences potentielles qui apparaissent lorsque le profil de l’acteur menaçant est présenté en plus du scénario, permettant ainsi d’adapter les plans de réponse des hôpitaux à la menace spécifique. En conséquence, deux scénarios contrastés sont présentés, générant un plan de réponse pour un groupe de pirates informatiques motivé géopolitiquement et un hacktiviste motivé idéologiquement. Cette approche pourrait être davantage appliquée à la préparation cybernétique dans les hôpitaux, en utilisant le processus décrit dans cette étude.
Les jeux agiles forment une catégorie de jeux sérieux particulière, par leur spécificité d’être, historiquement et avant tout, associés aux méthodes dites agiles. Ces méthodes sont apparues durant les années 1990 et se sont structurées autour d’un manifeste au début des années 2000. À l’origine ces méthodes étaient essentiellement destinées à mieux gérer des équipes de conception et de développement informatique. Depuis, leur champ d’application s’est étendu à la gestion de presque tous les types de projets et organisations. Le succès de certaines de leurs mises en application a rendu le qualificatif agile tendance, ce qui a mené à une surexploitation de ce dernier, comme élément de langage, pour qualifier une entreprise de compétitive ou d’innovante. Après une brève présentation de ces méthodes, nous abordons dans ce texte, ces jeux agiles qui ont été élaborés pour les promouvoir ou accompagner certaines étapes de leur mise en oeuvre. Nous en dresserons une cartographie de ces jeux qui a été réalisée à partir d’une collecte de données issue de cinq sites Web et d’un livre qui leur sont dédiés. Nous estimons à partir de cette collecte, la variété et de l’utilité de ces jeux. De fait, nous présentons différentes sous-catégories de ces jeux en les qualifiant, et en décrivant les plus populaires parmi les sources interrogées.
Cet article explore l’usage des jeux sérieux comme méthodes provocatrices en recherche. A partir d’une étude de cas détaillée de recherche par le jeu, les auteurs montrent comment le chercheur devient un agent provocateur qui influence les dynamiques étudiées, révélant des comportements autrement inaccessibles via des méthodes traditionnelles. Cette approche interdisciplinaire enrichit la recherche mais pose des défis en termes de validation des méthodes. Les jeux sérieux nécessitent des compétences variées et soulèvent d’importantes questions éthiques, notamment en ce qui concerne la protection des participants. En définitive, ils transforment la pratique de la recherche, favorisant une exploration plus créative et engagée des phénomènes sociaux.
La capacité d’un système informatique à analyser sémantiquement des textes passe notamment par l’interprétation de contenus de sens figuré. L’analogie est souvent utilisée afin de transmettre des idées nouvelles par similitude avec des idées connues. Il est possible de modéliser la comparaison et la métaphore sous la forme d’un carré analogique A : B : : C : D (signifiant A est à B ce que C est à D) avec une ou plusieurs variables dont il faut trouver les valeurs les plus pertinentes. Cet article présente deux jeux permettant de collecter des données lexicales en rapport avec les analogies. Le premier jeu, Analogia, est une adaptation de JeuxDeMots aux analogies, où le joueur doit fournir les réponses les plus pertinentes pour une analogie à une variable. Par exemple, trouver x pour "charbon est à noir ce que neige est à x". Le second jeu, Intersector, permet d’indiquer, en répondant à des questions, pour les 4 termes donnés d’une analogie, quels sont leurs points communs. Les termes proposés sont ceux issus des analogies du jeu Analogia. L’ensemble des données récoltées par ces jeux permet d’envisager une résolution automatique d’analogies, et donc l’interprétation de contenus figurés.
Cet article vise à présenter un ensemble de vocables et concepts : « Ludopédagogie », « Jeux Sérieux », « Gamification », « Ludification », « Ludicisation », « Jouet Sérieux », « Serious Game », « Serious Gaming », « Dégamification » et « Toyification ». Ils sont tous en lien avec la « ludopédagogie ». Pour contextualiser nos propos, nous prendrons pour support un artefact, à savoir une éponge. Cette démarche vise à montrer comment un simple artefact peut être instrumentalisé pour tour à tour faire découvrir différentes notions en lien avec le jeu et des applications à visées utilitaires. Nous verrons par une telle démarche que les constructions sociales et la subjectivité des individus sont à l’oeuvre pour appréhender tous ces termes.
Les étudiants du parcours Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P) du BUT GEA sont souvent focalisés sur l’obtention des résultats quantitatifs, c’est-à-dire essentiellement la réalisation de calculs et l’application de formules, ce qui limite leur compréhension des concepts managériaux et économiques travaillés. Pour corriger ce travers, une approche d’apprentissage à travers le jeu de rôle (JDR) appliqué à une étude de cas en contrôle de gestion est présentée. Cette méthode pédagogique engage les étudiants en les plongeant dans des scénarios pratiques qui nécessitent de mobiliser les concepts de contrôle de gestion. L’objectif est de montrer comment le JDR peut transformer l’apprentissage « scolaire » en compétences au travers d’une simulation de gestion scénarisée. Le document détaille l’organisation d’une session de JDR où les étudiants jouent le rôle de consultants, utilisant un jeu construit sur la base d’une annale d’examen (DCG -Diplôme de Comptabilité et de Gestion- 2011). Les étudiants, dans un contexte dynamique et interactif, sont amenés à appliquer théorie et analyses en renfort des aspects quantitatifs, ce qui favorise l’engagement, la collaboration et l’apprentissage autonome. Les résultats de cette expérience sont positifs, avec une majorité d’étudiants rapportant une meilleure compréhension des concepts de contrôle de gestion, un engagement accru, et une adhésion au travail d’équipe. Cependant, quelques points d’attention ressortent, comme la complexité des scénarios ou la gestion de la charge de travail.
Comment former des étudiants en alternance au management collaboratif ? Cette question de départ a guidé la construction du dispositif pédagogique présenté ci-après. Partant de la mise en place d’une expérience innovante de ludopédagogie, cette proposition invite à faire construire une théorie par les étudiants par l’intermédiaire d’un jeu. Trois fondements théoriques ont fourni une base à ce travail : l’apprentissage du management collaboratif, le jeu coopératif en contexte d’alternance et l’utilisation de la pensée visuelle. 23 étudiants en 2ème année de Master Management de Projets ont testé le jeu coopératif « Connec’ Team » avant de rédiger un retour d’expérience débouchant sur la construction d’une théorie managériale présentée sous la forme d’un sketchnote. Les retours des participants mettent en lumière l’intérêt de la ludopédagogie dans l’apprentissage du management collaboratif à travers l’usage d’un jeu. Le travail réflexif et de théorisation a été facilité par l’emploi de techniques pédagogiques qui font tomber des barrières habituellement inhibitrices pour les étudiants, en particulier la rédaction d’un texte abstrait.
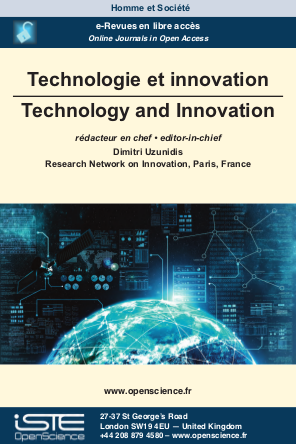
2026
Volume 26- 11
Les possibles de la décarbonation de l’industrie : au-delà du progrès technique2025
Volume 25- 10
La décarbonation : industrie, économie et politique2024
Volume 24- 9
Les filières de production dans la bioéconomie2023
Volume 23- 8
Intelligence artificielle et Cybersécurité2022
Volume 22- 7
Trajectoires d’innovations et d’innovateurs2021
Volume 21- 6
L’innovation collaborative2020
Volume 20- 5
Les systèmes produit-service2019
Volume 19- 4
L’innovation agile2018
Volume 18- 3
Innovations citoyennes2017
Volume 17- 2
Innovations de mobilité. Transports, gestion des flux et territoires2016
Volume 16- 1
Stimulateurs de l’entrepreneuriat innovant