

Sciences humaines et sociales > Accueil > Arts et sciences > Numéro
Qu’il soit physique, métaphysique ou psychologique, le vide est un concept polysémique et souvent paradoxal, généralement associé à l’absence (de matière ou de tout autre contenu), voire au manque. La question du vide hante l’humanité depuis toujours et accompagne toute l’histoire des sciences. Dans l’Antiquité grecque, Parménide puis Aristote ont nié son existence, les atomistes Leucippe et Démocrite ont au contraire affirmé son omniprésence dans l’univers. Depuis la révolution scientifique du XVIIème siècle jusqu’à la révolution relativiste et au-delà, les physiciens ont cherché à le créer et le conceptualiser. Au fil des théories du vide qui se sont succédé, l’opposition entre le vide et le plein s’est muée en complémentarité ou interdépendance, jusqu’à la théorie quantique des champs, où le vide complet est en continuité avec la matière. De leur côté, les artistes visuels ont d’abord représenté le vide en tant que faire-valoir des formes visibles, dans une complémentarité statique avec le plein, puis l’ont affronté en tant que tel, comme dans les « expositions du vide » de l’art contemporain. Dans la tradition picturale chinoise d’inspiration taoïste ou bouddhiste, cette complémentarité est au contraire une interpénétration dynamique, issue de la Vacuité originelle.
L’intelligence Artificielle arrive à produire des textes littéraires originaux et intéressants, des comédies humoristiques ainsi que des jeux électroniques passionnants. L’IA pourrait-elle nous aider à interpréter la vraie nature de l’art ? Pour réduire le problème dans un contexte rationnel, il faut préciser la question : un objet d’art est-il conçu selon une méthode mentale analogique, ou bien digitale ? Pour essayer d’établir une méthode pour encadrer cette question : dans quelle mesure la représentation de la figure humaine dans l’art est basée sur des dimensions cartésiennes ? L’histoire de l’art peut nous fournir des réponses.
Cet article présente une traduction inédite d’un extrait du poème Sacred Sites. The Secret History of Southern California composé par l’écrivaine et poète américaine Susan Suntree. Cette traduction est saisie comme une opportunité de discuter des avantages du vers libre pour non seulement raconter l’histoire de la Terre et du vivant, mais aussi cultiver chez le public une sensibilité plus accrue au temps. Cet article contribue ainsi à la réflexion sur le rôle des formes et techniques artistiques dans l’étude des temps géologiques, ou deep time. Commentant l’extrait traduit de Sacred Sites, il explique comment le vers libre constitue une forme poétique permettant simultanément de mettre en forme l’historicité de la Terre et d’exprimer quelque chose des conditions singulières dans lesquelles se trouvent ceux qui étudient cette historicité. Le potentiel éducatif et expressif du vers libre et d’autres formes poétiques pour partager le savoir et les perspectives géologiques doit être sérieusement examiné compte tenu de l’urgence de la crise environnementale.
Antoine Risso (1777-1844) est né et a vécu toute sa vie à Nice (France). Pharmacien de formation et de profession, il devint l’un des plus grands naturalistes de son temps. Risso a publié de nombreux ouvrages sur la flore et surtout la faune marines de sa région natale. Son opus magnum (1826) est un ouvrage en cinq volumes sur l’histoire naturelle de Nice et de sa région, traitant de géologie, de botanique et de zoologie : Histoire naturelle des principales productions de l’Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes maritimes. Les volumes comprennent de magnifiques planches en couleur, presque toutes réalisées par Jean-Gabriel Prêtre, l’un des peintres naturalistes les plus réputés de la première moitié du XIXe siècle. L’Histoire naturelle de Risso a fait l’objet de nombreuses critiques lors de sa parution. Cependant, on peut dire aujourd’hui qu’elle a passé l’épreuve du temps. Parmi les ouvrages publiés en 1826, l’Histoire naturelle de Risso figure parmi les cinq premiers en termes de nombre total de citations dans les revues académiques, aux côtés des ouvrages classiques de d’Orbigny sur les céphalopodes et de Malthus sur l’accroissement de la population. Cependant, l’oeuvre majeure de Risso est inconnue de la plupart d’entre nous, à l’exception peut-être des taxonomistes de poissons et des spécialistes de l’illustration scientifique. Nous tentons ici de présenter à un large public la vie d’Antoine Risso et son oeuvre majeure, ainsi que l’oeuvre de Jean-Gabriel Prêtre.
Le film d’animation de Jean-François Laguionie "Le voyage du prince" (2019), d’après "Le château des singes" (1999) du même réalisateur, inspiré du livre "Le baron perché", d’Italo Calvino (1957), est marqué par une prégnance végétale forte. Le film nous invite dans un monde de fiction, dans lequel les singes sont l’espèce animale principale – évoquant les humainsles humains les humainsles humains les humainsles humains les humains – représentée à travers des peuples aux modes de vie contrastés. Le monde végétal est présent dans toute sa diversité, et dans la richesse des transactions qui s’établissent entre les espèces. Pourrions-nous alors inventer et réinventer la "nature" ? Nous sommes invités, en suivant le baron et la façon dont le film s’en inspire, à contempler et questionner notre lien aux plantes. Comment les transactions établies avec elles et avec le reste du vivant font-elles le monde ? C’est ce que nous tenterons d’approcher.
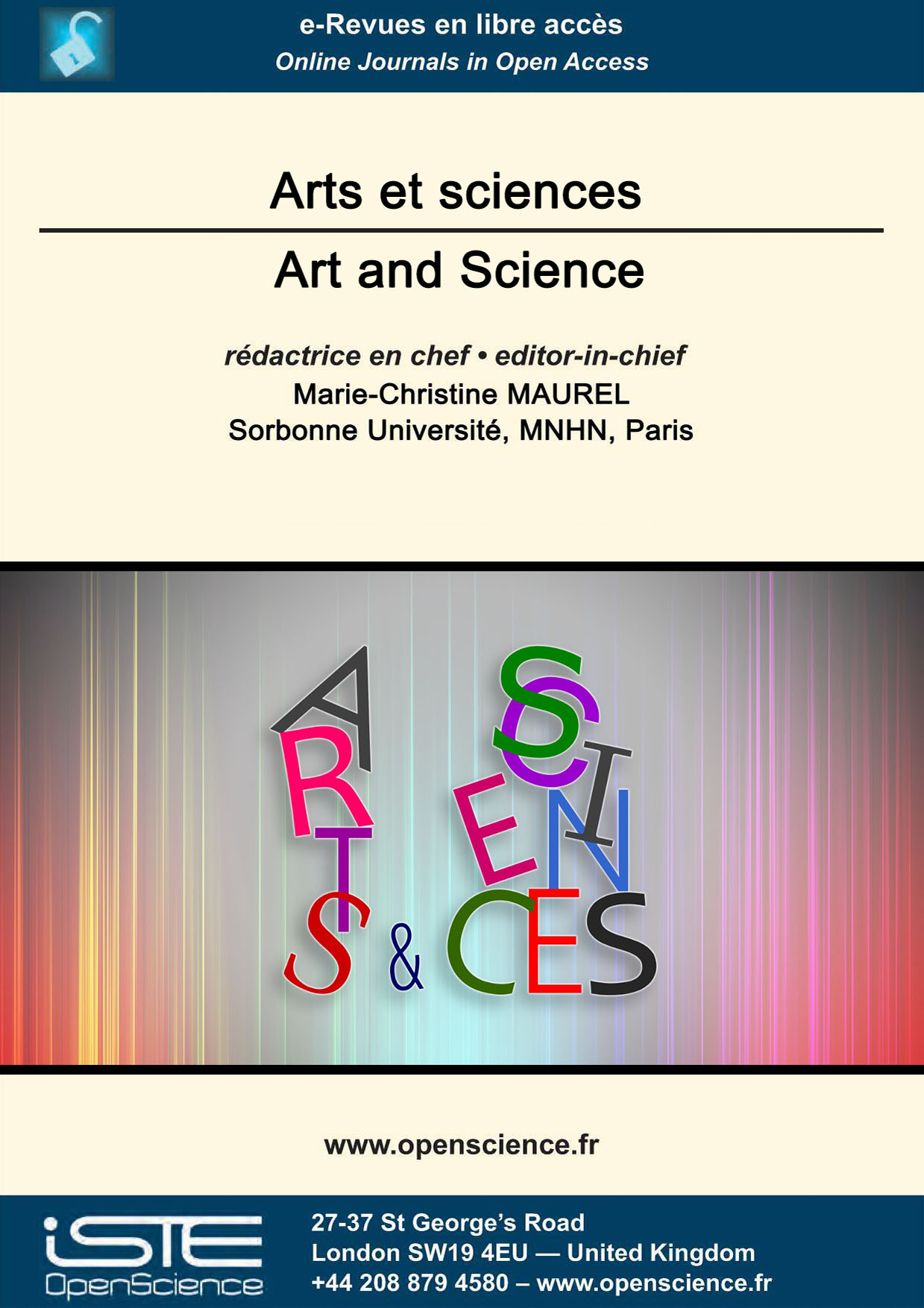
2026
Volume 26- 10
Numéro 12025
Volume 25- 9
Numéro 12024
Volume 24- 8
N° Spé : OOB2023
Volume 23- 7
Numéro 12022
Volume 22- 6
Numéro 12021
Volume 21- 5
N° Spé : Formes vivantes2020
Volume 20- 4
N° Spé : Des sciences écologiques aux arts du paysage2019
Volume 19- 3
Numéro 12018
Volume 18- 2
Numéro 12017
Volume 17- 1
Numéro 1