

Sciences humaines et sociales > Accueil > Archéologie, société et environnement > Numéro
Ce texte introduit la publication des rencontres tenues en novembre 2022 à l’Université de Nanterre à l’invitation du professeur Christophe Petit et de l’archéologue Jean-Yves Dufour. 16 communications ont permis un point d’actualité de la recherche sur le logis animal sur le territoire français. Cette courte introduction utilise les traités d’agronomie pour rappeler combien loger le bétail était important sous le climat de nos régions françaises.
Un grand nombre de travaux interdisciplinaires (archéologie, géoarchéologie et bioarchéologie) a porté sur l’étude de l’enregistrement sédimentaire des grottes-bergeries néolithiques et protohistoriques du Midi de la France, contribuant à caractériser les pratiques zootechniques liées à la conduite des troupeaux. La présence de sites spécialisés de type grotte-bergerie, exclusivement destinés au parcage, semble caractériser le Chasséen de l’arrière-pays méditerranéen et de la vallée du Rhône. En revanche, si les grottes-bergerie sont toujours utilisées au Néolithique final, elles ne le sont plus exclusivement pour le parcage. Les études archéozoologiques menées en Provence et en Languedoc mettent également en évidence la diversité fonctionnelle des sites d’habitat de plein air au sein de l’espace pastoral, tant pour une utilisation permanente que saisonnière. Sur les sites de La Capoulière et de Ponteau, les études géoarchéologiques ont permis de caractériser l’enregistrement sédimentaire des aires de parcage et d’identifier 1) des espaces voués au seul élevage des caprinés domestiques (moutons/chèvres) au sein de l’espace villageois de La Capoulière, et 2) des zones mixtes associant aire de stabulation pour les animaux domestiques et aire d’habitation humaine sur le site de Ponteau. Ces recherches permettent de préciser le rôle de l’habitat de plein air au sein de l’espace pastoral en Languedoc et en Provence à la fin du Néolithique, et de mieux qualifier les stratégies de gestion des troupeaux et l’usage de bâtiments d’élevage.
La question de l’identification du logement animal à partir de l’instrumentum est complexe, d’autant que le mobilier métallique propre à l’élevage et à la gestion des animaux est particulièrement réduit. Les fréquentes découvertes de sonnailles, par exemple, sont une illustration de l’animal hors les murs et posent la question du type de stabulation, abritée, ouverte ou mixte. Pour ce qui est du logement à proprement parler, les éléments découverts dans les établissements ruraux, pièces d’huisserie, renforts de coffres, chaînes ou pitons, renvoient au domaine immobilier de manière générique. Seuls les anneaux d’attache semblent spécifiquement rattachés à la sphère animale. Au thème de l’alimentation animale, et particulièrement au fourrage, sont liés des outils comme la faux. Toutefois, l’usage plus ou moins restreint de cet outil fait débat entre les auteurs, même si des mentions sont connues dans plusieurs textes antiques. Les crochets à foin, mis en évidence depuis peu, constituent probablement un indice sérieux quant au stockage de nourriture. La réflexion est également à mener sur les objets destinés à gérer les fumiers, à savoir les fourches, dont les deux formes connues, en bois et en fer, peuvent correspondre à deux usages différents. Les soins prodigués aux animaux seraient une dernière piste à suivre. Dans leur acceptation quotidienne, il s’agit essentiellement d’instruments destinés à entretenir le pelage et à éviter les infestations et les infections comme les étrilles. L’outillage propre au vétérinaire est plus problématique à mettre en évidence, tant nombre de pièces peuvent être semblables à celles utilisées pour la médecine.
Les marqueurs parasitaires font partie des indices directs utilisés en archéologie pour mettre en évidence la présence animale. À ce titre, ils contribuent à caractériser les animaux présents sur les sites, ainsi que leur état de santé. Certains parasites, associés à des hôtes spécifiques, peuvent conduire à une identification précise de l’animal présent (porc, cheval, volaille…). D’autres parasites, plus généralistes, ne permettent d’identifier que la catégorie à laquelle ces animaux appartiennent, carnivores et herbivores essentiellement. L’étude des parasites anciens contribue également à caractériser la fonction des vestiges liés au logis animal (espace de stabulation, abreuvoir…). Plusieurs exemples issus des analyses réalisées en paléoparasitologie permettront d’illustrer les apports de la discipline concernant les animaux présents sur les sites et leur milieu de vie.
L’agglomération de Fanum Martis est localisée à la frontière entre les territoires nerviens et atrébates. Les premières traces d’occupation antique sont datées du milieu du Ier siècle apr. J.-C. bien que quelques indices laissent à penser qu’une présence au début de ce siècle soit possible. À son apogée, au IIIe siècle apr. J.-C., elle couvre plus de 200 ha. Au cours du troisième quart du Ier siècle apr. J.-C., en périphérie du centre urbain, se développe un établissement agricole qui sera intégré à l’agglomération quelques décennies plus tard. Dans celui-ci, des stalles à chevaux ont été identifiées. Elles sont installées dans un vaste bâtiment devant abriter plusieurs espèces d’animaux. Leur agencement ainsi que les traces laissées correspondent à celles identifiées dans les camps militaires du Limes. Ce type d’aménagement, rarement identifié lors d’opérations archéologiques, pourra servir de modèle pour les fouilles futures en Gaule.
Les écuries du Fort Saint-Sébastien, camp de préparation à la guerre de siège des troupes de Louis XIV, constituent un exemple rare de camp de cavalerie livré par l’archéologie. Deux camps successifs aménagés en 1669 et 1670 ont livré d’abondantes données permettant de restituer, grâce à une large enquête interdisciplinaire, une image composite de cette société des gens de guerre du XVIIe siècle. Chevaux d’armes, chevaux de bât destinés à transporter les charges lourdes (notamment les pièces d’artillerie), chevaux de selle mais aussi mules et bidets font pleinement partie des effectifs de l’armée. Leur approvisionnement et leur entretien conditionnaient très largement l’organisation logistique et les calendriers de la guerre. Les vestiges laissés par les écuries ont permis de comprendre les rythmes d’implantation des régiments, les modes de castramétation1, mais aussi de révéler l’économie globale de ces camps militaires. En temps de paix, aux portes de Paris, l’entretien des chevaux était également une vitrine de la capacité opérationnelle des armées royales, destinées aux diplomaties européennes. Les écuries faisaient donc l’objet d’un investissement tout particulier et d’une construction plus coûteuse que lors du déplacement des troupes en campagne.
La fouille préventive d’une villa gallo-romaine à Ris-Orangis (Essonne, France) a pu mettre en oeuvre un ensemble d’études spécialisées (archéozoologie, cartographie des phosphores, analyse des biomarqueurs lipidiques fécaux) qui permettent d’interpréter l’un bâtiments d’exploitation comme une bergerie.
Dans le cadre de la fouille programmée réalisée au château du Haut-Clairvaux (Vienne) en 2018 et 2019, un bâtiment inédit du XIIe siècle a été fouillé au nord de la cour. Ce dernier, enseveli suite à un incendie et à l’installation de nouvelles constructions à la fin du XIIe siècle, conserve plusieurs structures et fosses dont une remplie d’une quinzaine de squelettes de chiens parfaitement conservés. D’après l’analyse archéozoologique, il s’agit vraisemblablement d’individus appartenant à une meute de chiens de chasse enterrée sur place. En outre, plusieurs indices laissent à penser que ce bâtiment aurait pu servir de chenil, une sorte de logis dans le logis.
Lors de la fouille d’espaces pouvant être interprétés comme des lieux dédiés aux animaux d’élevage, les approches bio- et géoarchéologiques sont de plus en plus souvent sollicitées pour venir en appui à l’interprétation basée sur les structures bâties. L’analyse palynologique n’est pas forcément la plus courante, car le bon état de conservation des grains de pollen requiert des conditions que l’on trouve généralement plutôt dans le remplissage des structures en creux, à savoir des milieux humides et à forte teneur en matière organique. Pourtant, les grains de pollen, tout comme d’autres microfossiles non-polliniques comme par exemple les spores de champignons saprophytes et/ou coprophiles peuvent être de bons indicateurs directs ou indirects de la présence animale. Ces dernières années plusieurs interventions d’archéologie préventive en Île-de-France ont été l’occasion de tester des analyses palynologiques sur des structures de différentes natures, tels que des sols de bergerie, d’étable ou encore de nichoir de poulailler. Les résultats obtenus ont montré des apports très positifs lorsque les conditions de conservation s’y prêtaient, notamment avec des couches sédimentaires organiques non perturbées et rapidement scellées après abandon.
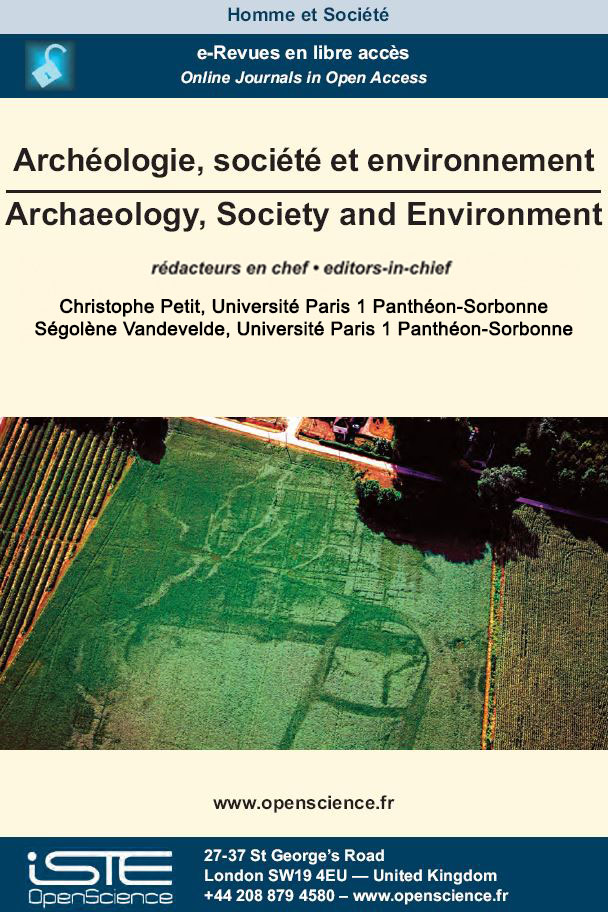
2026
Volume 26- 6
Numéro 12025
Volume 25- 5
Numéro 12024
Volume 24- 4
Numéro 12023
Volume 23- 3
Numéro 1 : Journées Bois2021
Volume 21- 2
Numéro 1 :2019
Volume 19- 1
Numéro 1 : Les carbonates archéologiques, mémoire des activités anthropiques