

Sciences humaines et sociales > Accueil > Archéologie, société et environnement > Numéro
Si l’approche géoarchéologique d’un site se concentre habituellement sur les zones de stockage sédimentaire telles que des vallons secs ou les structures anthropiques en creux pour appréhender les archives du sol, les axes viaires ou les dépressions naturelles de types thermokarstiques peuvent, elles aussi, constituer une source d’information pour le pédologue et le géomorphologue. Ainsi, le site de Faux-Fresnay « Le Haut des Taupinières », fouillé par l’Inrap en 2019 sur une superficie de 10 hectares, offre des perspectives nouvelles pour documenter les grandes phases de pédogenèse et les troncatures des sols, notamment à travers la présence d’un axe viaire médiéval, ayant préservé les horizons de rendosol holocène. Ce rendosol, également conservé à la faveur d’un vallon sec et de dépressions thermokarstiques hérités du Pléistocène, est anthropisé dès l’âge du Bronze puis subit, comme l’ensemble du site, une érosion polyphasée et diachronique. Les produits d’érosion stockés dans les dépressions thermokarstiques subissent régulièrement une reprise de pédogenèse, suggérant une rythmicité du couple érosion/sédimentation et la succession de périodes de stabilité et d’instabilité des sols. Pour caractériser la pédogenèse holocène et les différentes phases d’érosion du site, l’étude géoarchéologique s’appuie donc à la fois sur la réalisation de transects pédostratigraphiques, sur des analyses géochimiques (dosage de la matière organique et des carbonates), mais aussi sur les datations relatives offertes par les structures, fossoyées ou non, préservant ces horizons pédologiques à titre d’archives du sol. Ces structures anthropiques et les datations relatives qu’elles fournissent mettent notamment en lumière une première phase érosive postérieure à l’occupation du Bronze final à Faux-Fresnay, puis une accélération des processus érosifs au cours de la seconde moitié du Subatlantique, en lien avec l’agriculture mécanisée. L’utilisation des axes viaires anciens comme témoin des périodes d’érosion/sédimentation à l’échelle régionale peut également être étendue à d’autres contextes archéologiques, géomorphologiques et pédologiques. Ainsi, une remise en contexte à l’échelle régionale est possible à travers d’autres exemples d’axes viaires plus récents, parfois modernes à contemporain, ayant préservé les sols anciens et qui témoignent d’une morphogenèse colluviale accélérée depuis plus d’un demi-siècle.
Les caractéristiques de certains anthroposols suscitent un intérêt croissant en raison de leurs stocks élevés de carbone (C). C’est dans cette perspective que nous nous sommes intéressés à des anthroposols sud-américains et d’Afrique centrale. Les échantillons d’Amérique du Sud proviennent de trois sites archéologiques de la région du Llanos de Moxos en Bolivie (Isla Manechi, San Pablo et Isla del Tesoro). Au Cameroun, une équipe franco-camerounaise de l’Institut français de Recherche pour le Développement a collecté des échantillons dans deux types d’anthroposols (des sols sombres que nous avons appelés Dark soils et des remplissages de fosses archéologiques que nous avons appelés Refuse pits et dans des sols de forêt (Forest soils). L’objectif de ce travail est de détecter l’impact des activités anthropiques passées sur ces sols par des mesures spécifiques du statut organique des sols (teneurs et qualité du C organique du sol – Corg). L’originalité de ce travail réside dans la démarche empirique et dans l’utilisation d’une méthode rarement appliquée en archéologie, l’analyse thermique Rock-Eval®, pour quantifier et caractériser le carbone organique du sol. Les analyses thermiques des échantillons de sols des sites archéologiques ont été comparées entre elles et avec un modèle de référence. Les résultats montrent que dans les sites du Cameroun, le carbone mesuré est de nature organique. En Bolivie, nous avons considéré uniquement les formes de Corg même s’il y a une présence des formes de C inorganique à San Pablo et à Isla del Tesoro qui sont des « Shell middens ». Les résultats sur l’étude de la stabilité thermique de la matière organique du sol (MOS) soulignent que les sols des sites naturels (Forest soils) ou de déprise (Dark soils) ont une signature comparable au cas général construit à partir d’un ensemble de sols naturels non perturbés, alors que les sols des sites d’occupation humaine présentent un écart par rapport à ce modèle. Notre hypothèse est que cet écart permet de détecter le signe d’une occupation humaine ancienne. La valeur de cet écart pourrait refléter le degré d’intensité ou le type des activités anthropiques pratiquées sur ces sols archéologiques intertropicaux. Nous proposons un paramètre intégrateur pour mesurer le degré de perturbation de la MOS en relation avec l’emprise humaine sur les sols. Cette étude préliminaire suggère donc que la méthode permet a priori de détecter l’emprise des activités anthropiques sur les sols des sites archéologiques.
Depuis Hérodote et sa vision de l’Égypte comme un don du Nil jusqu’à nos jours, la civilisation égyptienne a été examinée sous de nombreux aspects. En observant la bibliographie égyptologique, la perception du paysage agraire et son exploitation semblent rester cependant généralistes, avec des connaissances imprécises, bien que certaines analyses géophysiques et géologiques aient été conduites dans la plaine depuis une dizaine d’années. En complément de ces approches géoarchéologiques, la lecture d’actes notariaux de l’époque ptolémaïque (IVe-Ier siècles avant J.-C.) permet de discerner et de repositionner précisément dans le paysage de la zone d’étude (Louxor) des éléments topographiques et des types de champs cultivés. L’analyse lexicographique de quatre termes démotiques utilisés pour qualifier les types de terres démontre non seulement que les Égyptiens distinguaient un sol par ses caractéristiques (rendement réel ou potentiel, composition, couleur) et son emplacement, mais montre également comment une lecture environnementale de ces contrats nous permet de faire progresser nos connaissances et de mieux saisir les nuances du paysage agraire.
L’illuviation particulaire existe aussi bien en contextes subarctiques/alpins que sub-arides. L’illuviation d’argiles fines ou silteuses est contrôlée via le pH par les propriétés géochimiques de surface des particules (loess, alluvions, plages fossiles ou dépôts de pente). Plusieurs processus peuvent entraver l’illuviation fine comme dans les paléoenvironnements acides, calcaires ou volcaniques. Le « point de charge nulle » (ZPC) de la surface minérale ou du complexe argilo-humique règle les conditions optimales de dispersion ou floculation des particules. Cela implique que ce processus illuvial est un facteur précoce lors l’évolution du sol, dans une fenêtre de pH étroite, mais peut être réactivé par le rajeunissement du sol après érosion ou par dépôt de loess, des apports superficiels naturels ou anthropiques, par enfouissement, par changement du fonctionnement hydrique ou de la couverture végétale. Les sols de nos régions résultent d’une histoire complexe et cumulative depuis au moins 50 voir 120 ka, modulée par l’évolution du climat et de la biosphère. Les revêtements argileux ne représentent pas nécessairement l’interglaciaire Holocène mais peuvent attester d’interstadiaires weichséliens, même très brefs, voire de l’interglaciaire précédent.
Pour comprendre plus finement les interrelations entre archéologie et pédologie, on peut décrire avec précision les objets visés et les protocoles utilisés par les uns et les autres, en confrontant des expériences concrètes et en tentant une montée en généralité pour construire la comparaison. Nous avons pris le parti ici d’y associer quelques considérations sur la métaphysique du temps car elles nous semblent trop peu utilisées dans l’exercice scientifique ordinaire, et pourtant susceptibles d’apporter des éclairages nouveaux. Ainsi, la distinction ontologique fondamentale entre événements et processus nous parait particulièrement féconde dans ce débat et permet de tempérer quelque peu toute tentative de fusion (ou d’intersection) entre ces disciplines.
À proximité de Metz, les fouilles préventives réalisées sur un versant de 5 ha de la commune de Woippy, ont mis au jour un domaine foncier, en activité entre le VIIe et le XIIe siècle. Les vestiges comprennent des zones d’habitats auxquelles on peut associer des zones de parcellaires et de cheminements. Ce versant qui présente une topographie à pentes fortes s’est développé sur un substrat limono-argileux à argilo-sableux peu perméable. Les indices carpolo-giques indiquant le type de cultures dans les parcelles existent mais de manière relativement discrète ; les différents horizons pédologiques découverts s’articulent avec le parcellaire en petites lanières, avec des traits pédologiques de lessivage plus ou moins marqués selon la position topographique. Par ailleurs, les fouilles ont mis au jour un système complexe de drains et de fossés collecteurs d’eau, qui a constitué une étape préliminaire à l’implantation des bâtiments et qui a organisé progressivement le parcellaire dans sa forme définitive. La gestion du ruissellement apparaît alors comme un paramètre déterminant dans la structuration archéologique du paysage, tout comme la nécessité de recréer des drains et des bassins de rétentions s’est imposée lors de la fouille en 2018 pour limiter l’impact du colluvionnement dans le village actuel.
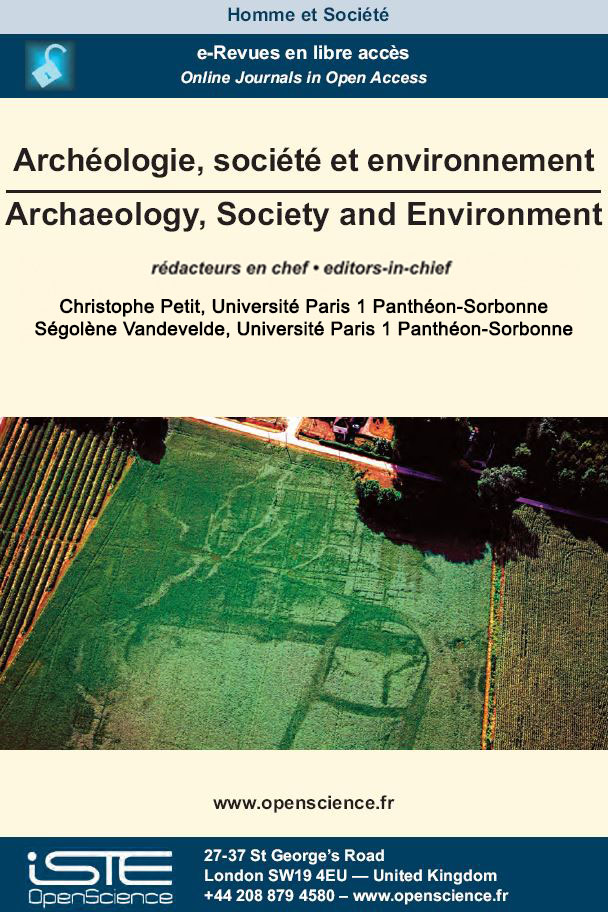
2026
Volume 26- 6
Numéro 12025
Volume 25- 5
Numéro 12024
Volume 24- 4
Numéro 12023
Volume 23- 3
Numéro 1 : Journées Bois2021
Volume 21- 2
Numéro 1 :2019
Volume 19- 1
Numéro 1 : Les carbonates archéologiques, mémoire des activités anthropiques