

Écologie et environnement > Accueil > Risques urbains > Numéro
Cet article étudie des formes d’expertise climatique territorialisée issues de collaborations entre chercheurs et acteurs urbains (collectivités, agences d’urbanisme). En mobilisant la notion d’objet intermédiaire, il analyse comment des dispositifs concrets (données, cartes, systèmes d’information géographique ou services climatiques) agissent comme des objets intermédiaires dans la co-construction des savoirs pour la prise en compte de l’adaptation dans l’action publique urbaine. À partir de trois cas d’étude (Toulouse, Dijon, Tunis), l’article met en évidence la diversité des configurations de collaboration depuis la simple consultation jusqu’à la recherche-action et la co-construction d’expertise climatique. Ces objets intermédiaires participent à l’émergence d’une expertise hybride, nourrissant un apprentissage mutuel et une acculturation réciproque entre scientifiques et praticiens. L’article souligne l’importance des conditions relationnelles, temporelles et interdisciplinaires dans la mise à l’agenda des enjeux climatiques et l’ancrage de l’adaptation au changement climatique dans l’action publique urbaine.
La forme de la ville, l’agencement de ses rues, de ses bâtiments et de ses espaces verts peuvent modifier significativement la circulation du vent dans l’espace ouvert et la quantité de rayonnement solaire reçue par les bâtiments et les surfaces. Le vent et le rayonnement affectent directement la surchauffe urbaine et la dispersion des polluants en ville, et par conséquent la qualité de l’environnement urbain et le confort des habitants. Développer, dans le contexte de la géomatique, des modèles qui permettent de relier directement des caractéristiques de l’environnement construit à des champs de vents ou d’ensoleillement permet d’éclairer la décision politique. Cet article vise à mettre en évidence les relations entre le calcul de certaines variables physiques et des méthodes de géomatique, à décrire des expériences de modélisation de la physique radiative et aéraulique de la ville dans le contexte du SIG, et également à relever certains verrous scientifiques ou techniques qui subsistent dans le domaine.
Les approches et normes de représentation cartographique des outils SIG standards peuvent être éloignées des usages des différents types d’utilisateurs étudiant ou devant prendre en compte les phénomènes climatiques urbains (urbanistes, météorologues, climatologues, etc). Elles peuvent s’avérer insuffisantes pour représenter la complexité des phénomènes, caractérisés par une variabilité spatiale tridimensionnelle et temporelle. A travers les résultats de différents projets de recherche, ce chapitre s’intéresse aux nouvelles approches pour représenter et explorer les données climatiques à l’échelle urbaine. La première partie aborde la question des utilisations et des normes de représentation des données climatiques et météorologiques dans les zones urbaines et intra-urbaines densément peuplées, en tenant compte à la fois des besoins opérationnels et de la communication avec le public. Une seconde partie porte sur les approches de visualisation pour l’analyse de données simulées dans un contexte scientifique, et aborde les approches pour représenter ces données dans leur complexité, par l’usage d’outils 3D. Enfin, le chapitre aborde l’intérêt d’associer les utilisateurs à la conception des représentations graphiques des données climatiques.
Les données dérivées sont des données construites à partir d’un traitement sur des données géospatiales brutes pour une utilisation thématique identifiée. Cet article vise à présenter les éléments relatifs à ces objets largement utilisés dans les domaines de la climatologie urbaine et de l’analyse territoriale. Plusieurs concepts liés aux données dérivées sont d’abord définis, dont la notion d’unité spatiale de référence. Une liste non exhaustive de données dérivées est présentée, notamment des indicateurs morphologiques et physiques. Une sélection de typologies et classifications de tissus urbains à différentes échelles spatiales sont également introduites. Les applications et les utilisations de ces données dérivées sont détaillées, notamment concernant la création de données d’entrée pour les modèles de simulation climatique, l’analyse climatique et le diagnostic territorial. L’article pointe en conclusion les limites des données dérivées, et les répercussions de ces dernières sur la qualité de l’information produite.
Le changement climatique bouscule les agendas de recherche ainsi que les priorités d’aménagement urbain. Pour les métropoles françaises de nombreux événements viennent perturber les territoires, parmi lesquels les inondations et les canicules. Les réaménagements urbains pour faire face à ces enjeux sont coûteux et se programment sur des échelles de temps longs. La simulation numérique est un formidable outil pour étudier des scénarios d’évolution urbain et étudier l’efficacité de solutions d’aménagements. En matière de climat urbain des modèles numériques existent et sont progressivement améliorés par les communautés scientifiques. Ces modèles sont paramétrés, entre autres, par les données géographiques qui décrivent les surfaces minérales (les bâtiments, les sols asphaltés) les surfaces non minérales (les surfaces d’eau, les sols herbacés, les sols nus perméables) et les canopées arborées. Dans cet article nous étudions l’adéquation des données topographiques existantes pour la paramétrisation de modèles climatiques. Nous commençons par rappeler l’importance des spécifications des bases de données pour comprendre l’écart entre le monde réel et le contenu des bases de données. Nous décrivons ensuite des stratégies pour construire des données d’occupation du sol adaptées à l’étude du climat urbain à partir de référentiels nationaux et en l’absence de ces référentiels. Enfin nous réfléchissons aux perspectives de l’apport des données très grandes échelles, de type BIM, pour l’étude des climats urbains. En conclusion nous proposons une amélioration des spécifications des bases de données géographiques nationales pour mieux répondre aux besoins d’aménagement du territoire dans le contexte du changement climatique.
Les outils de diagnostic du climat urbain peuvent être utiles aux autorités locales et aux villes : ils fournissent des informations pour la planification urbaine et la conception de projets de développement à différentes échelles spatiales, dans un contexte d’atténuation du changement climatique mondial et d’adaptation aux pics de chaleur localement. Dans le document suivant, nous identifions et répertorions les outils de diagnostic, en nous concentrant principalement sur les outils géoclimatiques. Ces derniers ont la particularité de nécessiter des données géomatiques et géographiques pour fournir des résultats utiles au diagnostic de la surchauffe dans les villes. Une classification de ces outils est présentée, basée sur quatre critères. Le premier critère est basé sur la manière dont le tissu urbain est pris en compte par chacun des outils : simplifié ou détaillé. Le deuxième critère est le type de résultat produit par le logiciel : il contient des quantités physiques ou des informations qualitatives (par exemple, ombre ou soleil). Le troisième critère est relatif au choix de l’approche de résolution du problème : physique ou statistique ? Le dernier critère concerne le type de physique abordé par l’outil logiciel (température de l’air, vent, rayonnement, etc.). Enfin, les outils sont triés selon cette classification et leur relation avec la géomatique est décrite plus en détail. Il apparaît que chaque outil a été développé pour un besoin particulier et d’un point de vue spécifique. Ce point de vue permettra également d’expliquer les forces, les faiblesses et les simplifications de chaque outil. Enfin, il met en évidence les domaines dans lesquels le développement de logiciels, ou même de modèles, requiert l’attention des sciences des SIG.
L’îlot de chaleur urbain et la pollution de l’air en ville, risques sanitaires majeurs en ville, peuvent être mesurés par des réseaux de stations fixes ou des mesures mobiles en milieu urbain. Des protocoles ont été mis en place pour avoir une représentativité de problématiques climatiques et de pollution de l’air à différentes échelles spatiales et temporelles. L’objectif de cet article est de présenter les réseaux de mesures existants, les protocoles mis en place dans les recherches françaises, et les représentations spatiales des données issues de ces mesures. Le panorama fait permet d’avoir une vision des questions scientifiques et techniques à avoir pour mettre en place des mesures climatiques et de pollution de l’air.
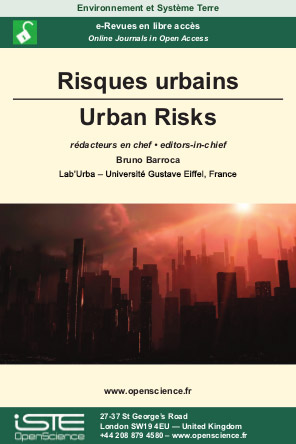
2025
Volume 25- 9
Numéro 12024
Volume 24- 8
Numéro 12023
Volume 23- 7
Numéro 12022
Volume 22- 6
Numéro 12021
Volume 21- 5
Numéro 12020
Volume 20- 4
Numéro 12019
Volume 19- 3
Numéro 12018
Volume 18- 2
Numéro 12017
Volume 17- 1
Faire la ville résiliente pour faire la ville plus sûre